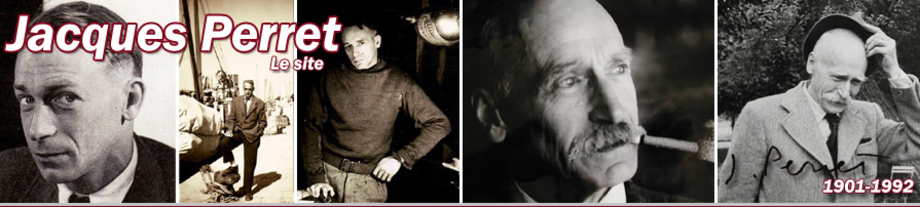
L’hebdomadaire Arts poursuit une enquête sur les jeunes. C’est une enquête consciencieuse et intelligente, mais je trouve qu’on devrait d’abord leur fiche la paix, aux jeunes. C’est corrompre la jeunesse que lui inculquer des préoccupations d’adultes. Notre siècle a pris de la jeunesse une sollicitude alarmante. Il a promu à son intention le mot « jeune » au rang de substantif à majuscule ; il lui a fabriqué des ministères spéciaux, il a même confié des portefeuilles très sérieux à des galopins qui, entre parenthèses, se sont révélés plus dénués d’imagination et plus rabougris dans la doctrine que nos augustes vieillards.
Il y a un engouement, un mythe, une extrapolation snobée, une démagogie, une technique enfin de la jeunesse. On l’a tirée des limbes heureuses pour l’engager dans la congrégation sociale ; le déterminisme historique lui a ouvert pompeusement ses portes. Des prophètes bénis ou cornus lui ont révélé plus ou moins confusément ses aspirations souveraines, ses droits incohérents, ses missions imprescriptibles. La République de Jouvence a découvert que l’avenir appartenait aux jeunes et que ce truisme méconnu aurait des conséquences immédiates et nécessaires. Désormais les jeunes gens formeraient dans l’État, non plus une pépinière hasardeuse au caprice des pères et à la grâce de Dieu, mais une classe organisée, choyée, dûment assurée, attributaire, alignée en solde et loisirs, conditionnée à l’œil socio-électronique.
Le pré-salaire qui sera consenti aux étudiants pour les soulager d’une condition médiévale, et mieux les coincer dans le piège à matricule, sera étendu aux lycéens pubères, en attendant que soient légalement définie la profession de jeune, et promulguée la loi sur la retraite des jeunes, proportionnelle à partir du bachot.
Les niais s’extasient devant la belle gravité de l’étudiant soucieux du lendemain, conscient de son rôle et gouverné par un idéal de sécurité cosmique. Ce jeune homme est un infirme ; on lui a coupé les jarrets. L’enquête en question nous montre des garçons de dix-huit ans fort inquiets de savoir comment ils vont loger leur petite famille et quel salaire y suffira, compte tenu des avantages sociaux. Voilà une jeunesse de tout repos ; la République apparemment n’a rien à craindre de ce côté-là. Les grèves d’étudiants ont elles-mêmes un petit côté rassurant ; elles témoignent d’un sens social orthodoxe et vigilant. Si leur monôme est un peu turbulent, ce n’est pas qu’ils pincent le derrière des filles, puisqu’ils sont tous fiancés, mariés, sinon pères de famille ; ce n’est pas non plus, à moins qu’il s’agisse de jeunes arriérés, pour insulter la Chambre des Couards qui laisse invengée la mémoire du capitaine Moureau. Non, c’est pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’insuffisance des locaux scolaires ou le taux de remboursement des lunettes.
Aux jeunes candidats à l’École des Mousses, on avait demandé pour quelles raisons ils avaient choisi cette voie. Il s’est trouvé une demi-douzaine de gamins pour répondre à cause de la retraite. Soyons beaux joueurs et saluons ici une des plus belles conquêtes du progrès social.
Tout cela, bien entendu, est éphémère. Si la cité socialiste n’est pas engloutie par le cours sacré de l’Histoire, elle sera la proie d’un bel incendie dû à l’imprudence d’un fumeur ou à un court-circuit entre la nature et la doctrine. Mais la malveillance n’est pas exclue. En ce cas, l’incendiaire sera peut-être un vieillard extra-lucide ; on se plaît davantage à imaginer une bande de copains, providentielle survivance des jeunesses mérovingiennes boutant le feu au grand fichier matriculaire, simple histoire de rigoler.
A quoi rêvent les jeunes gens, Aspects de la France, 22 mars 1957, n°445A retrouver dans Du tac au tac, Editions Via RomanaLa fête des fous se célébrait jadis, une fois l'an, aux alentours de la Saint-Étienne. On promenait le pape des fous sur un âne à travers les rues parmi toutes sortes de parodies, les hiérarchies étaient sens dessus dessous, on se payait la belle récréation de mettre le monde à l'envers, c'était une bonne détente et salutaire pour tout le monde. Les pisse-froid mis à part, nul ne s'indignait de voir le plus réputé des ivrognes, le plus moqué des clochards ou le plus farfelu des truands présider la fête, revêtu des ornements du pouvoir et des insignes sacrés. Ainsi, le comité des fêtes de Paris vient-il d'ouvrir la grande saison par la remise de la croix de guerre à M. Maurice Thorez. L'idée était bonne mais, décidément la République ne sait pas rire comme nos aïeux, ses fêtes sont minables, ses liesses gourmées, tout ce qu'elle entreprend dans ce genre reste mesquin, froid et miteux. Elle lésine et gâche ainsi ses meilleures trouvailles. Cette ingénieuse remise de décoration a fait long feu. Seul un petit nombre de privilégiés a pu se taper sur les cuisses entre deux portes alors que, bien montée, la cérémonie devait offrir au bon peuple assez de pintes de bon sang pour renouveler de bon cœur le mandat des joyeux mirliflores de la IVe Cascadeuse.
Il fallait faire une prise d'armes, précédée d'une revue à Longchamp et suivie d'un cortège où le Prince des Fantassins, le Patron des Biffins du Premier Jour, revêtu de son harnais et fraîchement croisé de vert et rouge, eût caracolé par toute la ville sur un âne, un dromadaire, un zèbre, un dahu ou tout autre animal propre à exciter l'enthousiasme du peuple. On aurait vu dans l'escorte MM. Kriegel et Mornet, par exemple, vêtus d'hermine et rendant la justice sur un char de velours blanc traîné par les ribaudes. Et, naturellement, fontaines de vin, violons, arcs de triomphe, pétards, bals publics et carrousel en place de grève des généraux de la promotion Peyré. Au Vel' d'Hiv' M. Bouglione eût présenté le gala télévisé des anciens présidents du Conseil au cours duquel M. Vincent Auriol eût prononcé une allocution radiodiffusée pour affirmer une fois encore que la République est et restera fondée sur la vertu, tandis qu'à ces mots un feu d'artifice monstre eût éclaté sur la ville pour marquer le point culminant de la fête. Voilà ce qu'il fallait faire. Mais la République n'a pas le sens des gaietés vraiment populaires ; elle trahit encore l'héritage des sinistres austérités jacobines, elle va même parfois jusqu'à donner l'impression de se prendre au sérieux. Bien sûr, on aimerait croire qu'elle n'est, au fond, qu'une pince-sans-rire impayable qui se pince sans rire depuis un siècle et demi et qui prolonge sans sourciller la Fête des Fous dont seuls s'esclaffent à la cantonade quelques initiés bénéficiaires. Les Français ont omis de renvoyer à la cour des miracles les fous qu'ils avaient couronnés un jour, histoire de rire, et les fous se sont mis à croire tout bonnement à leur sceptre, à leur pourpre, à leur hermine, à leurs crises de conscience, à leurs sceaux, à leur légende et à leurs vents. Ou à faire semblant. Mais le règne des fous qui traîne en longueur n'est plus une rigolade, les bonnes gens pressés par leurs affaires s'installent paresseusement dans le carnaval et s'habituent à prendre les vessies pour lanternes, les lanternes pour soleil, les ânes pour palefrois, les galimatias pour vérités éternelles, les traîtres pour héros, les héros pour traîtres, les magistrats pour juges, les Schrameck pour Durand, les scrutins pour grand'messe, la lie de piquette pour chambertin, le socialisme pour fraternité, un mirliton pour un homme, un ramassis pour un parlement, la sécurité sociale pour une libération et la démocratie pour un ordre naturel. La fausse monnaie, c'est amusant un jour ou deux ; elle est même indispensable au bon équilibre des peuples et à l'hygiène de la civilisation, elle donne aussi à réfléchir à la bonne monnaie qui aurait tendance à s'infatuer. Mais quand il n'est plus battu d'autre monnaie que fausse, on ne sait plus reconnaître la bonne et nous voilà rendu à cette confusion générale et invétérée dont Clément d'Alexandrie a dit qu'elle sentirait le soufre à plein nez."La fête des fous", Aspects de la France, 18 mai 1950, n°92La France n’est peut-être plus une grande nation, mais il y a toujours chez les Français de quoi faire le plus grand peuple. C’est une vérité à laquelle je tiens beaucoup, même si les preuves se font rares ou discrètes. Je pourrais, cette semaine, affermir ma foi sur une preuve d’ordre politique en célébrant la réélection de M. Albert Sarraut, vieux marabout du tripot parlementaire, et lanterne des sublimes secrets, mais la gloire de M. Sarraut appartient à la Troisième, et l’odeur de ses vertus n’est plus qu’un relent. Plus volontiers je chanterais nos victoires techniques, le nouveau pétrolier de 33 000 tonnes, le stator géant de 170 tonnes, et la locomotive BB 9004, qui s’apprête à pulvériser le record du monde, mais si j’ai beaucoup de respect pour ces machines, je ne les considère pas moins comme des accessoires.
En revanche, il m’apparaît que le rugby français nous permet aujourd’hui d’envisager l’avenir avec beaucoup de confiance. Quand une équipe nationale de rugby arrive à cette qualité, c’est un signe, et je n’en dirais pas autant du golf ou même du bridge. Ce n’est pas souvent que je parle ici de sport, et pourtant je lui dois des moments exquis. Vous savez que samedi dernier nous avons battu l’Écosse. Sauf le respect que je dois au souvenir des Stuarts bien-aimés, je dirais même que nous avons battu les Écossais à plate couture.
Deux fois par an, dans la période où se déroule le tournoi des Cinq Nations, je vais à Colombes voir gagner la France et m’en égosiller de joie. Et si elle ne gagne pas, elle a montré assez de vertu pour contenter notre orgueil et gonfler notre espoir. Ajoutez à cela l’émotion d’une foule en même temps accordée par la connaissance du jeu et l’honneur du clan français. L’enthousiasme collectif est un phénomène hasardeux qui fait aussi bien la ruine ou le bonheur de sociétés, mais il est sot de le mépriser quand il se manifeste à propos d’un débat aussi hautement civilisé, aussi probant, qu’une partie de rugby. Ce n’est pas parce que nous avons acquis en cette matière une valeur incontestable que je vante les vertus de cette épreuve. Même aux temps de nos revers, j’ai toujours tenu le rugby pour le plus beau des jeux. Et si les États devaient régler leurs querelles sur le pré sportif, c’est encore par le rugby que s’exprimerait le mieux les différentes valeurs des nations.
Si notre quinze tricolore fait aujourd’hui un des purs chefs-d’œuvre de la qualité française, le mérite en revient tout de même quelque peu aux sélectionneurs. Certes, la sélection ne se fait pas toujours dans une sérénité olympienne on la soupçonne embarrassée d’intrigues, de coterie et de querelles de prestige, mais ces faiblesses ne font jamais que préférer un indiscutable champion à un autre indiscutable champion. La raison du rugby n’est jamais perdue. Il faut dire que pour constituer une équipe de rugby et une équipe ministérielle, on ne s’y prend pas de la même façon.
L’espoir en ballon, Aspects de la France, 14 janvier 1955, n°331Tirer la fève. On dit que la coutume nous vient des saturnales, mais on dit beaucoup de choses, que le christianisme est légataire universel de tous les rites et mythologies en perpétuel aggiornamento et qu’en fin de compte le chrétien n’est qu’un païen recyclé. Ce n’est peut-être pas le moment d’encourager les visions de ce genre si le diable s’en occupe. Nous savons bien que la révélation a pris en charge un héritage qui fut trié avec soin, nettoyé, converti. Que la galette ait eu affaire avec Saturne, ce n’est pas bien grave, nous l’avons baptisée tout de suite, ses parrains les rois mages n’ont pas toujours été catholiques non plus.
Sans avoir inventé la galette nous l’avons élevée à la dignité royale et adoptée pour dessert épiphane en lui gardant sa fève, nourriture des pauvres et symbole de fécondité. Les boulangers aidant, la coutume s’est maintenue jusqu’à nous sauf que la fève a dû se retirer du jeu en cessant d’être cultivée. Mettons que le haricot sec ait eu quelques droits à lui succéder, mais le fayot de terre cuite, simulacre stérile, allait donner carrière à toutes les fantaisies de la céramique et précipiter la pagaille des signes. L’avènement et la vogue d’un petit nourrisson emmailloté fit croire un instant au pieux complot qui ramènerait l’enfant Jésus au souvenir des convives, mais le bébé fut tout de suite et bizarrement appelé baigneur. Sous ce nom il n’avait plus grand espoir d’entrer au service de la tradition. On eut beau faire ici et là quelques efforts pour le sortir de sa condition profane, le baigneur l’emporta. Mieux encore, on nous persuade aujourd’hui que n’importe quoi fait fève. Relâche, facilité, laxisme, erreur, il n’y a pas de n’importe quoi. Dans la dernière fournée ils ont trouvé moyen de glisser dans nos galettes un petit bouddha, ce n’est pas n’importe quoi, même pas n’importe quel bouddha. Il est gras et ventru, accroupi dans une posture inhabituelle, son nombril est situé à l’intersection des bissectrices d’un triangle aigu où il s’abrite comme sous une chape. Un expert pourrait nous dire à quelle secte bouddhiste nous devons ce gadget de solidarité spirituelle au bénéfice d’une épiphanie de synthèse, adulte et mondiale. Les inquiets se sont interrogés sur la mission de ces micro-bouddhas introduits subrepticement dans le sein feuilleté de l’Occident ; ils y soupçonnent la main de Mao, le petit véhicule mystique aux gages de la révolution, la pilule de nirvana pour l’abrutissement des derniers factionnaires de la chrétienté. Les conciliateurs ont tout simplement fêté la surprise du quatrième roi mage, on n’attendait plus que lui pour découper la galette suprême au symposium des prophètes mélangés. Quoi qu’il en soit je me demande pourquoi la présence d’une figurine orientale humblement nichée dans la plus populaire de nos pâtisseries familiales pourrait nous surprendre ou nous alarmer quand le Saint-Père nous rapporte encore un bouddha dans ses bagages et qu’au Vatican, paraît-il, on ne sait plus où les mettre.
Itinéraires, Le cours des choses, 1972
En effet, le vieillissement accéléré de la population est un problème à la fois économique et sentimental. Il n'y aura de solution que dans une qualité de vie également répartie du premier au troisième âge. Occupons-nous de celui-ci et voyons un peu les expériences en cours.
Pour commencer, il ne sera plus question de vieillesse ni de vieillards ; ce sont là des mots crus dont le réalisme est douloureusement ressenti par les ayant droits. L'autorité du langage administratif et journalistique, magnifié par toutes les voix des mass media, peut déjà se flatter d'avoir popularisé en les ressassant les expressions « troisième âge » et « personnes âgées ». Au demeurant, si la douceur des périphrases est agréable aux chnoques, on ne peut pas dire qu'il s'agisse là d'innovations. Hector en usait couramment à l'égard de Priam et les enfants de Clovis eux-mêmes, chères petites têtes blondes et tout coquins fussent-ils, en comblaient leur vieux père. Mais le débordement des sollicitudes officielles dont les personnes zâgées sont aujourd'hui l'objet a pris l'ampleur d'un engouement et, soit dit sans venin, il peut s'en suivre un petit revenant-bon en période électorale. Le succès du troisième âge dans l'opinion publique est assez prouvé par son budget fabuleux. On va jusqu'à murmurer, dans un sourire attendri, que les personnes zâgées qu'on voyait naguère se traîner à la queue des soupes populaires, sont aujourd'hui nourries à domicile du sang des travailleurs. On sait que la pullulation démographique traversée par la philanthropie galopante pose des problèmes. Or, comme il a coutume de le faire en réponse aux questions brutales des voltigeurs de l'interviou, Giscard a dit : « Pas de problèmes ! » C'est pourquoi ceux-ci donneront lieu à création d'un sous-secrétariat du Troisième Age dont l'étude est en cours au comité de l'expansion ministérielle. Ce quarante-troisième portefeuille sera contrôlé lui aussi et au premier chef par la Qualité de Vie, autorité de tutelle par excellence. Toutes nos excellences ont d'ailleurs les yeux fixés sur V.G.E., modèle et étalon de la Q.V.
Si mes observations vous paraissent inconvenantes ou même teintées de mauvaise foi, empressons-nous de les justifier. Remarquons d'abord que tout ce déploiement de zèle et de propagande au bénéfice des grands-pères a précisément lieu dans une société qui nous paraît consentir par ailleurs et paresseusement à la destruction progressive et légale des structures, us et coutumes familiales. On m'excusera si j'ai même entrevu l'hypothèse où ces gâteries ne seraient que l'appât d'un piège à vieillard. Conçus tout exprès pour eux, des parcs d'attractions s'organiseraient ici et là de telle sorte qu'éblouis et tourneboulés par les révélations d'une vie de qualité, les pensionnaires n'en voudraient plus sortir. Il serait alors bien facile, un jeu d'enfant, de procéder à l'extermination du troisième âge, ne serait-elle que morale. On en finirait une bonne fois avec la légende, le respect, la sagesse, le prestige imposteur des personnes zâgées, insolente et parasitaire engeance.
Je n'en parle pas à la légère. Nous avons des commencements de preuves. Nous avons pu voir une émission télé-réclame en faveur d'un centre d'accueil et d'accession à la qualité de vie du troisième âge : sur fond musical pop des grands-pères travaillent au tapis leurs muscles abdominaux, des grands-mères en minijupe s'évertuent à des exercices de flexion extension des bras, de vénérables créatures sont initiées aux libérations du yoga, des couples séculaires aspirant au troisième souffle s'évertuent à danser la bamboula cependant que d'ineffables duègnes s'abandonnent aux derniers raffinements du massage automatique, et que d'antiques ménagères en relaxation sur fauteuil médical, les yeux clos la bouche ouverte, se font tripoter le visage par de joviales esthéticiennes, et tapoter les poches et pinçoter les rides au chant d'une trompette frémissante etcetera. Visions de cauchemar, le casino des zombies, on se refait une beauté, on se met en forme pour le jugement dernier, Edgar Poë extrapolé par Léon Bloy, mise en scène du Grand Guignol.
Un jour les enfants s'étaient concertés discrètement : « Alors ? On essaye d'envoyer pépé et mémé au gérontorium ? Ils y ont droit. » Ailleurs on disait le grand dab et la vioque.
Les chnoques aux chiottes ! Ce graffiti au crayon feutre et calligraphié dans la station de métro Mouton-Duvernet sur une affiche représentant un vieux couple hilare se goinfrant d'une friandise philanthropique, c'est la modeste rançon du traitement Q.V. pour personnes zâgées. Chnoque moi-même l'inscription n'était pas de ma main. »
Itinéraires, n° 201, mars 1976, Le cours des choses






